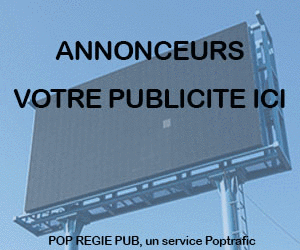Qu’elle soit célébrée religieusement ou civilement avec des chocolats, la fête de Pâques reste une tradition solidement ancrée. Mais contrairement à Noël ou à l’Assomption, elle n’a pas lieu à une date fixe. Chaque année, il faut guetter sur le calendrier quand tombent la célébration et le lundi férié qui va avec. Alors pourquoi ce changement permanent ?
La réponse trouve ses origines il y a près de deux millénaires, au temps de Jésus, lorsque la Pâque juive a été fixée au 14 nissan du calendrier hébraïque, soit le jour de la pleine lune de printemps, note le site de l’Église catholique. Ce calendrier, toujours utilisé dans la religion juive de nos jours, est constitué de 13 mois en fonction des cycles lunaires.
Un concile au IVe siècle fixe les bases
Puis, au IIe siècle, l’Église a souhaité que sa fête de Pâques ait lieu à une date proche de celle des Juifs. Le débat a fait rage entre plusieurs communautés de croyants, jusqu’en 325. L’empereur romain Constantin le Grand a alors convoqué le concile de Nicée, pour que l’ensemble des représentants du christianisme arrive à un accord sur une date commune. À l’issue de cette réunion majeure, il a été arrêté que la fête de Pâques aurait désormais lieu « le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après ». Comprendre le premier dimanche qui arrive en suivant la pleine lune après l’équinoxe de printemps.
De ce fait, la date de Pâques peut varier entre le 26 mars et le 23 avril. Celle de 2025 est donc parmi les plus tardives. Le calendrier futur des cinq prochaines célébrations témoigne de cette rotation inégale en fonction des années : le 5 avril en 2026, le 28 mars en 2027, le 16 avril en 2028, le 1er avril en 2029 et le 21 avril en 2030.
Une célébration plus tardive chez les orthodoxes
La fête de Pâques connaît aussi des variantes en fonction des courants de la chrétienté : les orthodoxes célèbrent en général plus tard que les catholiques et les protestants la résurrection de Jésus. En cause, leur différend avec Rome au XVIe siècle lorsque le pape Grégoire XIII a décrété de rattraper le retard de 10 jours sur le calendrier solaire accumulé en un millénaire.
Une bulle papale a alors été diffusée pour annoncer le passage du 4 au 15 octobre en 24 heures. Mais les chrétiens d’Orient n’ont pas souhaité suivre cette doctrine du Saint-Père. Ils continuent donc de célébrer Pâques avec 13 jours de retard par rapport à notre calendrier grégorien, note La Vie. Mais en raison d’un calendrier lunaire propre, les orthodoxes ne calculent pas l’arrivée d’une nouvelle lune de la même manière. Les dates peuvent donc certaines années coïncider, comme en 2025, ou diverger. Ce sera le cas en 2026 avec une Pâque orthodoxe au 12 avril.
Source: Le Parisien